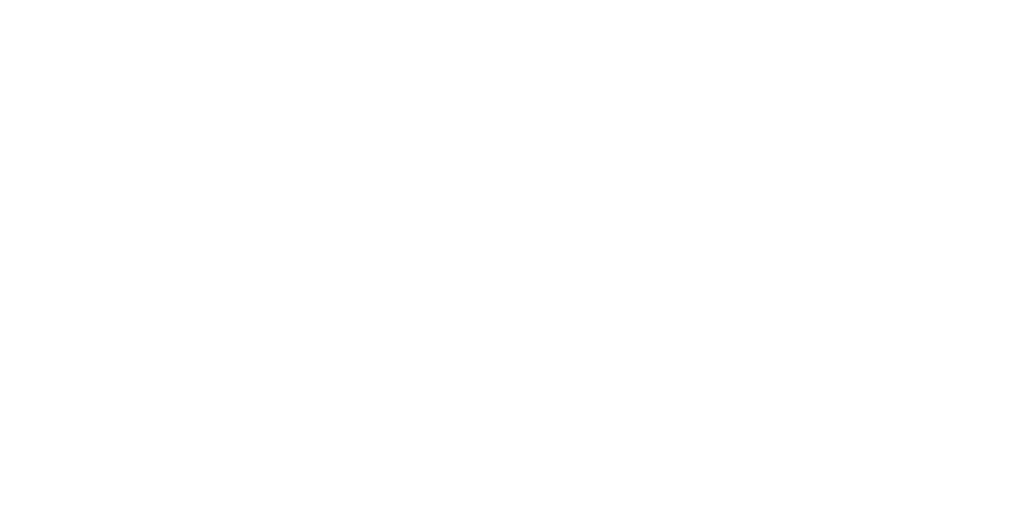Depuis 2022, un nouveau mécanisme encadre l’abandon de poste : la présomption de démission. Loin d’être une simple réforme technique, ce dispositif bouleverse la gestion de ces situations pour les employeurs et fragilise les droits des salariés. Encore mal connu, son application soulève de nombreuses questions juridiques et pratiques.
Un salarié qui ne revient pas : démissionnaire par défaut ?
L’article L.1237-1-1 du Code du travail prévoit qu’un salarié qui abandonne volontairement son poste et ne répond pas à une mise en demeure de justifier son absence et de reprendre son travail est présumé avoir démissionné. Cette mise en demeure doit être adressée par lettre recommandée ou remise en main propre, avec un délai fixé par l’employeur.
Ce dispositif a été pensé pour lutter contre les abus : certains salariés quittaient leur poste sans justification et étaient licenciés, ouvrant ainsi droit à l’assurance chômage. La présomption de démission entend y mettre un terme en requalifiant l’abandon de poste en rupture volontaire du contrat de travail.
Un décret incomplet, une jurisprudence corrective
Le décret du 17 avril 2023 devait préciser les modalités d’application de cette mesure. S’il fixe bien un délai de réponse, il reste silencieux sur le contenu exact de la mise en demeure. Cette lacune a été partiellement comblée par le Conseil d’État, dans un arrêt du 18 décembre 2024. Il y est affirmé que le salarié doit être clairement informé, dès la mise en demeure, des conséquences de son inaction, notamment du risque de voir son contrat de travail rompu sans indemnité chômage.
Cette décision contredit d’ailleurs les premières communications du ministère du Travail, qui laissaient entendre qu’il s’agissait d’une simple faculté pour l’employeur. En pratique, une mise en demeure imprécise ou incomplète pourrait rendre la procédure invalide.
Une procédure formelle à manier avec précaution
La jurisprudence récente montre que les juges sanctionnent sévèrement les erreurs de formulation. La cour d’appel de Paris, par exemple, a annulé une procédure car l’employeur n’avait pas utilisé les bons termes dans sa lettre. La formule « justifier son absence ou reprendre son poste » n’est pas conforme à la lettre du Code du travail, qui impose de faire les deux : justifier et reprendre.
On voit ici à quel point la procédure est exigeante. Il ne suffit pas d’envoyer un courrier ; encore faut-il qu’il soit parfaitement rédigé, précis et informatif.
Motif légitime : la seule arme du salarié
Face à cette présomption, le salarié n’est pas démuni. Il peut la renverser en prouvant l’existence d’un motif légitime d’absence : maladie, exercice du droit de grève ou de retrait, instruction illégale, etc. Cette liste, issue de l’article R.1237-13 du Code du travail, est indicative. D’autres situations peuvent être reconnues comme légitimes par le juge.
Encore faut-il que le salarié réponde à la mise en demeure dans le délai imparti et fournisse des éléments de preuve. Dans plusieurs affaires récentes, les conseils de prud’hommes ont rejeté les motifs avancés trop tardivement ou sans justificatif convaincant.
Certains juges vont jusqu’à assimiler le silence du salarié à un comportement fautif, et considèrent qu’il libère l’employeur de toute obligation, même celle d’organiser une visite médicale de reprise après un arrêt. Ce glissement du terrain contractuel vers le disciplinaire interroge.
Et les salariés protégés ?
Un arrêt de la cour d’appel de Paris du 6 mars 2025 a rappelé que l’employeur doit obtenir l’autorisation de l’inspection du travail avant de rompre le contrat d’un salarié protégé, même en cas de présomption de démission. Cette position, qui n’est pas expressément prévue par la loi, souligne l’ambiguïté du dispositif : s’il s’agit d’une démission, pourquoi requérir une autorisation administrative ? Et si l’employeur reste à l’initiative de la rupture, n’est-ce pas alors un licenciement déguisé ?
Conclusion : un mécanisme à manier avec prudence
La présomption de démission est un outil puissant pour les employeurs, mais il repose sur une procédure très encadrée. Le moindre manquement formel peut entraîner son invalidation. Côté salarié, le moindre silence peut être interprété comme une volonté de démissionner, sauf à justifier rapidement son absence par un motif légitime avéré.
Dans un contexte où la jurisprudence se cherche encore, il est essentiel de rédiger avec soin chaque mise en demeure, de documenter chaque étape et, pour les salariés, de réagir rapidement pour préserver leurs droits. Il ne fait aucun doute que la Cour de cassation aura bientôt l’occasion de poser des balises claires à ce régime encore jeune… et déjà controversé.